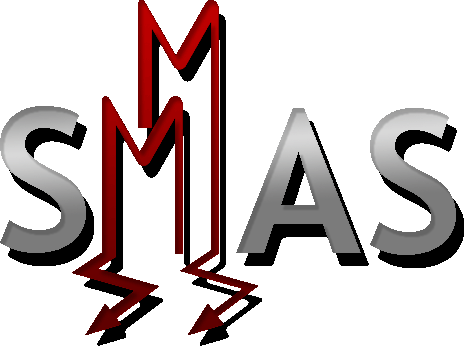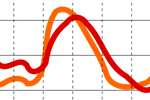Adiabatique
Advection
Albedo
Anomalie
Anticyclone
Arcus
Averse
Bow echo
Buisson de débris
CAPE
Chaleur latente
CIN
Cisaillement
Complexe convectif mésoscale
Convection
Convergence
Coup de chaleur
Courant ascendant
Courant de densité
Courant descendant
Courant Jet
Courant subsident
Creusement explosif
Dédoublement cellulaire
Dépression
Derecho
Divergence
Dôme pénétrant
Dorsale
Eclair
Flottabilité
Forçage
Foudre
Front
Front de rafale
Goutte froide
Grain en arc
Grain en vagues
Grêle
Grésil
Hélicité
Inversion
Jet de basse couche
LEWP
Ligne de grain
Macrorafale
Marais barométrique
Mésocyclone
Microrafale
Niveau de condensation
Niveau de convection libre
Niveau d'équilibre thermique
Nuage-mur
Nuage tabulaire
Orage de formation arrière
Orage à propagation rétrograde
Orage en V
Orage monocellulaire à pulsation
Orage monocellulaire cyclique
Orage monocellulaire simple
Orage multicellulaire
Orage multicellulaire à protubérances
Orage supercellulaire
Orage supercellulaire HP
Orage supercellulaire LP
Orage supercellulaire LT
Pied de pluie
Sillage turbulent
Sommet outrepassant
Système convectif mésoscale
Thalweg
Tonnerre
Tornade
Trombe
Tropopause
Vorticité
Terme inexistant dans le vocable météorologique, cette expression, utilisée sans modération par les médias, est à bannir impérativement de notre vocabulaire. La "minitornade" n'a de sens que dans la bouche d'un journaliste qui ne comprend rien à ce qu'il dit. Vous entendrez et lirez donc régulièrement au sein du monde journalistique, ce mot à qui l'on prête pour sens tout et n'importe quoi. Ainsi les médias regroupent-ils sous cette terminologie, tout phénomène venteux destructeur, quel qu'il soit (rafales, tempêtes, cyclones tropicaux), y compris les tornades "véritables" (la EF4 de Hautmont du dimanche 3 août 2008 était également nommée "minitornade" par les médias).
Adjectif qualifiant toute transformation physique, chimique ou biologique, associant deux systèmes qui n'échangent pas d'énergie thermique entre eux. Appliqué à la météorologie et tout particulièrement à la convection, il caractérise alors la transformation d'une particule d'air qui s'élève, et subit des variations de température (en raison de la variation de pression) indépendamment de l'air extérieur dans lequel elle progresse.
Déplacement horizontal d'une particule d'air.
Grandeur physique définissant le pouvoir réfléchissant d'une surface, déterminée par le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie sur l'énergie lumineuse incidente. Toute surface dont l'albedo tend vers 0 apparaît noire car elle absorbe l'énergie lumineuse, et toute surface dont l'albedo tend vers 1 apparaît blanche car elle réfléchit l'énergie lumineuse.
Perturbation de l'équilibre local d'un paramètre atmosphérique. Nous parlons par exemple d'anomalie de pression, ou d'anomalie de température.
Centre et zone de hautes pressions, l'anticyclone est associé à un mouvement subsident de masse d'air, responsable d'un réchauffement et d'un assèchement de l'air. La circulation des vents autour de l'anticyclone, sous l'effet de la force de Coriolis, se fait dans le sens horloger dans l'hémisphère nord. Du fait de cette circulation subsidente, l'anticyclone inhibe fortement la formation de nuages, il est associé à un temps froid et sec, voir glacial, en hiver, et chaud et sec, voir caniculaire, en été.
Rouleau nuageux, sombre et de basse altitude, qui précède le front de rafale d'un cumulonimbus. L'arcus est le résultat de l'interaction entre le courant de densité du cumulonimbus et le cisaillement ambiant. L'air chaud et humide qui précède le système se retrouve soulevé en altitude. L'arcus est souvent le siège d'une vorticité horizontale.
Voir les dossiers Instabilité et convection et Cisaillement et interactions .
Episode de précipitations (pluie, neige, grêle...) caractérisé par un début et une fin brutale, l'averse est également associée à de brusques variations d'intensité.
Voir le dossier Hydrométéores et précipitations.
Terminologie anglaise utilisée pour nommer une ligne de grain arborant un écho-radar arqué. Le bow echo, ou grain en arc, est un système orageux multicellulaire puissant représentant un stade intermédiaire entre la ligne de grain classique et le derecho. Les grains en arc sont généralement associés à de très fortes rafales de vents, pouvant localement dépasser 160 km.h-1.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Accumulation de débris emportés par les vents et rassemblés au pied d'une tornade. Le buisson de débris s'apparente à un nuage venant grossir la base d'une tornade. Il se colore en fonction de la teinte des matières qu'il transporte.
Voir le dossier Vortex et tornades.
Acronyme pour Convective Available Potential Energy. Littéralement : énergie convective potentielle disponible. La CAPE, s'exprimant en joules, est une considération énergétique qui estime la capacité qu'a l'atmosphère de générer des mouvements verticaux du fait des forces de flottabilité.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Terminologie ancienne, la chaleur latente correspond à l'enthalpie de changement d'état de la matière. Il s'agit de la quantité d'énergie nécessaire de fournir à un corps pour qu'il change d'état. En météorologie, l'enthalpie de vaporisation, et surtout l'enthalpie de condensation liquide des molécules d'eau, qui sont responsables de transferts d'énergie thermique, sont indispensables à la mise en place d'une convection profonde. A grande échelle, ces changements d'état de l'eau permettent l'advection de grandes quantités d'énergie.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Acronyme pour Convective INhibition. Littéralement : inhibition convective. La CIN, s'exprimant en joules, estime l'énergie qu'il faut fournir à une particule d'air pour vaincre les forces de flottabilité négative qui s'y appliquent, afin de l'amener à son niveau de convection libre.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Appliqué au fluide atmosphérique, le cisaillement caractérise un état où le module et/ou la direction des vents varie en fonction de l'altitude (cisaillement vertical) ou de la position à la surface du globe (cisaillement horizontal). Parmi tous les facteurs qui entrent en jeu dans la formation et la longévité des orages, le cisaillement vertical est des plus déterminants.
Voir le dossier Cisaillement et interactions.
Système orageux de très grande dimension, issu de la fusion de plusieurs orages multicellulaires. Répondant à des critères de validation bien définis (selon Maddox), leur taille sur le terrain peut dépasser 500 km de grand axe.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Terme général regroupant l'ensemble des processus physiques générés lorsque l'atmosphère est instable sur le plan de la flottabilité. La convection est principalement associée à des mouvements verticaux. Ce sont les phénomènes convectifs qui sont à l'origine des orages et des phénomènes qui leur sont liés.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Appliquée à la météorologie, la convergence des flux consiste au déplacement de différentes masses d'air les unes vers les autres. Le rejoignement de ces flux d'air crée une accumulation de masse locale qui génère sous certaines conditions des mouvements verticaux. La convergence en basse couche est par exemple un élément essentiel dans la genèse et l'entretien des phénomènes orageux où elle tient lieu de forçage et de source d'alimentation.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Dénommé heat burst par les anglosaxons, le coup de chaleur est un événement météorologique rare caractérisé par un brutal renforcement des vents, une brutale hausse des températures et un brutal abaissement du point de rosée. Non totalement élucidé à ce jour, ce phénomène trouverait son origine sous des cellules convectives en phase de dissipation, ou bien à bases très élevées, surplombant des basses couches très sèches. La vaporisation des particules précipitantes générerait alors un courant de densité, à la manière d'une rafale descendante sèche, puis les particules subsidentes subiraient une compression adiabatique, à la manière d'un effet de foehn.
Voir le dossier Courants descendants et rafales.
Flux transportant de l'air verticalement et vers le haut. Si l'on se concentre sur les phénomènes convectifs, le courant ascendant issu d'une flottabilité positive génère et alimente les nuages convectifs et les orages, il peut alors être très intense et atteindre, voir même dépasser, 150 km.h-1. L'agencement de ce flux d'air et de son inverse, le courant descendant, est un élément capital dans la longévité des systèmes orageux.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Flux transportant de l'air verticalement et vers le bas, synonyme de courant descendant ou courant subsident. Dans le contexte des phénomènes convectifs, le courant de densité est issu d'une flottabilité négative, et généré à la fois par le poids des précipitations et leur évaporation. L'agencement et l'interaction de ce flux d'air avec son inverse, le courant ascendant, est un élément capital dans la longévité des systèmes orageux.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Flux transportant de l'air verticalement et vers le bas, synonyme de courant de densité ou courant subsident. Dans le contexte des phénomènes convectifs, le courant descendant est issu d'une flottabilité négative, et généré à la fois par le poids des précipitations et leur évaporation. L'agencement et l'interaction de ce flux d'air avec son inverse, le courant ascendant, est un élément capital dans la longévité des systèmes orageux.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Flux d'air rapides (classiquement 100 à 200 km.h-1), circulant en haute troposphère, sous la tropopause, déterminant des couloirs de vent intense s'étirant sur des milliers de kilomètres, une centaine de kilomètres de large, et quelques kilomètres d'épaisseur. Ces courants tirent leur origine des énormes contrastes thermiques siègeant dans les étages atmosphériques inférieurs.
Voir les dossiers Instabilité et convection et Cisaillement et interactions.
Flux transportant de l'air verticalement et vers le bas, synonyme de courant de densité ou courant descendant. Dans le contexte des phénomènes convectifs, le courant subsident est issu d'une flottabilité négative, et généré à la fois par le poids des précipitations et leur évaporation. L'agencement et l'interaction de ce flux d'air avec son inverse, le courant ascendant, est un élément capital dans la longévité des systèmes orageux.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
A nos latitudes tempérées, un creusement dépressionnaire explosif se définit comme une diminution de pression barométrique excédant 30 hPa par 24 heures au centre d'une dépression. Tel était par exemple le cas des dépressions responsables des tempêtes Lothar et Martin, les 26 et 27 décembre 1999.
Voir les dossiers Cyclogénèse et perturbations.
Division d'une puissante cellule convective, sous l'effet de l'interaction d'un cisaillement tournant avec sa circulation interne, générant ainsi deux cellules filles généralement supercellulaires.
Voir les dossiers Cisaillement et interactions.
Centre et zone de basses pressions, la dépression est associée à un mouvement ascendant de masse d'air, responsable de la formation de nuages et de précipitations. La circulation des vents autour de la dépression, sous l'effet de la force de Coriolis, se fait dans le sens anti-horloger dans l'hémisphère nord. Lorsque le gradient de pression est très serré autour de ce centre de basse pression, la dépression engendre des vents parfois violents, par exemple lors des tempêtes hivernales.
Voir les dossiers Cyclogénèse et perturbations.
Système convectif mesoscale consistant en une ligne de grain extrêmement puissante. Rare, le derecho constitue l'un des plus dangereux systèmes multicellulaires de par les rafales descendantes extrêmes qu'il génère.
Voir les dossiers Les orages multicellulaires.
Appliquée à la météorologie, la divergence des flux consiste à l'éloignement centrifuge de différentes masses d'air issues d'une même zone. L'éloignement de ces flux d'air crée une diminution de masse locale qui génère sous certaines conditions des mouvements verticaux. La divergence en haute troposphère est par exemple un élément favorisant dans la genèse et l'entretien des phénomènes orageux où elle tient lieu de forçage, un peu comparativement à la convergence en basse couche.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Synonyme de sommet outrepassant, il se manifeste visuellement comme un dôme, souvent éphémère, situé au dessus de l'enclume d'un cumulonimbus. Il résulte de l'importante énergie cinétique du courant ascendant de ce cumulonimbus, qui amène ces ascendances à forcer localement la tropopause. Ces sommets outrepassants témoignent donc d'une poussée convective intense, telle qu'elle peut être observer par exemple dans les orages monocellulaires à pulsation ou les orages supercellulaires.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Crête de hautes pressions barométriques, la dorsale tire son origine d'un anticyclone et s'étire entre deux zones de plus basses pressions. La dorsale est à l'anticyclone ce que le thalweg est à la dépression.
Voir les dossiers Cyclogénèse et perturbations.
Seule manifestation visible de la foudre, l'éclair est en fait généré par un plasma, lui-même créé par l'échauffement extrême (15000 à 30000 °C) des molécules de gaz atmosphérique au passage du courant électrique. L'éclair est suivi du tonnerre, de façon plus ou moins rapprochée en fonction de son éloignement par rapport à l'observateur.
Voir le dossier Electricité atmosphérique et foudre.
Synonyme de poussée d'Archimède, la flottabilité consiste en la force qui s'applique sur un corps baignant dans un fluide. Si la densité du corps est supérieure à celle du milieu environnant, la flottabilité est dite négative, et la force est dirigée vers le bas. Si au contraire la densité de ce même corps est inférieure à celle du milieu environnant, la flottabilité est positive, et la force est dirigée vers le haut.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Toute force s'appliquant sur une particule d'air située dans un environnement stable du point de vue de la flottabilité, et qui permettra à cette particule de s'élever jusqu'à son niveau de convection libre. Les phénomènes de forçage sont indispensables à l'éclosion de toute cellule convective.
Voir le dossier Instabilité et convection.
D'une façon générale, nous nommons coup de foudre une décharge électrique de nature électrostatique se produisant à partir d'un cumulonimbus, que les conditions thermodynamiques internes qui l'animent ont permis d'électriser, et la surface du sol, ou entre différentes régions du même cumulonimbus. Visuellement, un coup de foudre est matérialisé par un éclair. Il est ensuite suivi de tonnerre. Dans le domaine plus spécialisé de l'étude des orages, nous appelons uniquement coup de foudre une décharge nuage-sol.
Voir le dossier Electricité atmosphérique et foudre.
Limite située entre deux masses d'air de propriétés physiques différentes (température et humidité). Classiquement, dans les perturbations des moyennes latitudes, nous identifions trois principaux types de front, à savoir le front chaud à l'avant de la perturbation, le front froid à l'arrière, et parfois un front occlus, qui se forme lorsque le front froid rattrape le front chaud qui le précède. Le mécanisme de la frontogenèse demeure extrêmement complexe.
Voir les dossiers Cyclogénèse et perturbations.
Limite antérieure du courant de densité d'un cumulonimbus, le front de rafale, dont la manifestation visuelle est variable mais arbore souvent un arcus ou nuage tabulaire suivi d'un sillage turbulent, concentre souvent les vents les plus forts générés par le système orageux, tornade exceptée. Le passage du front de rafale s'accompagne d'un brutal renforcement des vents, d'une chute des températures et d'une brusque hausse de pression atmosphérique.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Volume d'air froid individualisé en altitude, s'isolant généralement à partir d'un creux barométrique d'altitude, et évoluant en une dépression d'altitude. Sur les cartes météorologiques, la goutte froide est représentée par des isothermes fermés. Les gouttes froides font parties des moteurs des dégradations orageuses.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Ligne de grain arborant un écho-radar arqué, le grain en arc, ou bow echo, est un système orageux multicellulaire linéaire puissant représentant un stade de sévérité intermédiaire entre la ligne de grain classique et le derecho. Les grains en arc sont généralement associés à de très fortes rafales de vents, pouvant localement dépasser 160 km.h-1.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Ligne de grain arborant à l'écho-radar une structure linéaire présentant plusieurs protubérances arquées et dont l'ensemble ressemble ainsi à une succession de vagues. Le grain en vagues, ou LEWP (Line Echo Wave Pattern), est un système orageux multicellulaire puissant représentant habituellement un stade de sévérité intermédiaire entre la ligne de grain classique et le derecho. Les grains en vagues sont généralement associés à de très fortes rafales de vents, pouvant localement dépasser 160 km.h-1.
Précipitations solides dont l'hydrométéore élémentaire est une particule de glace d'un diamètre supérieur à 0,5 cm nommée grêlon, elles sont générées par un cumulonimbus dans des conditions thermodynamiques complexes et non totalement élucidées à ce jour. Les grêlons deviennent dangereux et destructeurs dès 2 cm, ils possèdent généralement un diamètre inférieur à 5 cm, mais ils peuvent toutefois atteindre ou dépasser 10 cm de diamètre dans certains systèmes orageux particulièrement puissants.
Voir le dossier Précipitations et hydrométéores.
Précipitations solides dont l'hydrométéore élémentaire est une particule de glace d'un diamètre inférieur à 0,5 cm, et générées par un nuage convectif. Ces particules sont très souvent translucides et particulièrement rebondissantes. Elles se recontrent préférentiellement au cours des giboulées de début du printemps sous nos latitudes, et tombent alors des premières cellules convectives.
Voir le dossier Précipitations et hydrométéores.
Rotation imposée à une masse d'air par son environnement, l'hélicité est déterminée à la fois par la vitesse des flux et par l'intensité des cisaillements. Exprimée en m2.s-2, elle s'interpète comme l'énergie des cisaillements, et donne une précieuse indication sur le potentiel tornadique d'une masse d'air.
Voir le dossier Cisaillement et interactions.
Couche de l'atmosphère où la température augmente avec l'altitude.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Flux d'air dont les propriétés sont analogues à celles du courant Jet, mais dont les dimensions (espace et module) sont beaucoup plus modestes. De plus, comme leur nom l'indique, ces courants circulent à basse altitude. Ils sont très souvent associés aux zones frontales.
Voir les dossiers Cisaillement et interactions et Cyclogénèse et perturbations.
Ligne de grain arborant à l'écho-radar une structure linéaire présentant plusieurs protubérances arquées conférant à l'ensemble du système une ressemblance à une succession de vagues. Le LEWP (Line Echo Wave Pattern), ou grain en vagues, est un système orageux multicellulaire puissant représentant habituellement un stade de sévérité intermédiaire entre la ligne de grain classique et le derecho. Les grains en vagues sont généralement associés à de très fortes rafales de vents, pouvant localement dépasser 160 km.h-1.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Système orageux multicellulaire, dont les cellules sont alignées les unes à côté des autres selon un schéma linéaire. Les lignes de grain, ou lignes de rafale, du fait d'une convergence et d'un cisaillement marqués, sont souvent associées à des phénomènes orageux intenses. Ainsi il n'est pas rare d'observer sous ces orages des phénomènes convectifs violents. Les lignes de grains peuvent adopter des configurations, d'une puissance croissante, en arc (bow echo), en virgule, en vagues (LEWP) ou à l'extrême, en derecho.
Voir les dossiers Les orages multicellulaires.
Rafale de vent d'origine convective, dont la durée de vie se situe entre 5 et 20 minutes, et affectant une zone géographique d'au minimum 4 kilomètres de diamètre. Les plus violentes macrorafales dépassent 160 km.h-1, et peuvent parfois atteindre les 200 km.h-1.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Zone atmosphérique peu perturbée, à tendance dépressionnaire mais avec de très faibles gradients barométriques, située entre deux champs de hautes pressions. Du fait d'une très faible circulation générale en son sein, il arrive qu'une forte accumulation de chaleur s'y concentre durant les journées estivales, générant alors des orages désorganisés d'évolution diurne.
Voir le dossier Cyclogénèse et perturbations.
Habituellement associé aux orages supercellulaires, le mésocyclone est une zone de rotation au sein d'une ascendance convective, d'un diamètre compris entre 3 km et 10 km. La circulation atmosphérique qu'il induit peut faire le lit, sous certaines conditions, de la formation d'une tornade.
Voir les dossiers Cisaillement et interactions et Les orages supercellulaires.
Rafale de vent d'origine convective, dont la durée de vie est inférieure à 5 minutes, et affectant une zone géographique de moins de 4 kilomètres de diamètre. Les microrafales sont générées par une brutale et courte intensification du courant de densité d'un nuage convectif. Ces rafales peuvent s'accompagner de précipitations (nous parlons de microrafales humides) ou non (nous parlons alors de microrafales sèches). Comme pour les macrorafales, l'accélération des vents au sein d'une microrafale peut atteindre des valeurs extrêmes jusqu'à 200 km.h-1.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Altitude à laquelle une particule d'air humide, après avoir subi une ascendance sous l'effet d'une force extérieure et avoir été refroidie par détente, atteint son niveau de saturation. La vapeur d'eau se condense alors, et un nuage apparaît. Ce niveau est visuellement identifiable sous un nuage convectif par sa base sombre et plate.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Altitude à laquelle une particule d'air humide, s'élevant sous l'impulsion d'une force extérieure, atteint son niveau de flottabilité positive, sous l'effet de la libération de chaleur latente de condensation de son contenu en eau, et du dépassement de la température d'état. A partir de ce niveau, la particule devient instable sur le plan de la flottabilité et poursuit d'elle-même son ascencion verticale.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Altitude à laquelle une particule d'air atteint son niveau de flottabilité négative. Il s'agit d'un plafond quasiment insurpassable contre lequel les ascendances convectives viennent se heurter et s'étaler. Dans le cas d'une convection profonde, ce niveau coïncide habituellement avec la tropopause. Ce plafond est visuellement identifiable en périphérie d'un orage par le sommet de son enclume.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Formation nuageuse correspondant à une base surbaissée d'un cumulonimbus, par rapport au niveau de condensation principal, le nuage-mur correspond à la base d'un courant ascendant intense et très humide. L'abaissement du niveau de condensation est imputée au refroidissement local provoqué par le courant de densité.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Structure nuageuse s'apparentant à un arcus, mais dont la section de profil est en coin, le nuage tabulaire précède le front de rafale d'un cumulonimbus. Il résulte de l'interaction entre le courant de densité du cumulonimbus et le cisaillement ambiant. L'air chaud et humide qui précède le système se retrouve soulevé en altitude.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Système orageux animé d'une propagation qui s'effectue contre le flux principal, l'orage de formation arrière, ou encore à propagation rétrograde, évolue dans un environnement cisaillé particulier et généralement associé à une forte convergence en basse couche. Visuellement, il s'agit soit d'un orage stationnaire, dont les nouvelles cellules se reforment indéfiniment dans la même zone géographique, soit d'un orage animé d'un mouvement de recul par rapport au flux dominant, donnant ainsi l'impression de faire marche arrière.
Voir le dossier Cisaillement et interaction.
Système orageux animé d'une propagation qui s'effectue contre le flux principal, l'orage de formation arrière, ou encore à propagation rétrograde, évolue dans un environnement cisaillé particulier et généralement associé à une forte convergence en basse couche. Visuellement, il s'agit soit d'un orage stationnaire, dont les nouvelles cellules se reforment indéfiniment dans la même zone géographique, soit d'un orage animé d'un mouvement de recul par rapport au flux dominant, donnant ainsi l'impression de faire marche arrière.
Voir le dossier Cisaillement et interaction.
Système orageux à propagation rétrograde, principalement méditerranéen, l'orage en V est caractérisé sur l'imagerie satellite par la forme générale d'un V. La pointe du V représente la zone la plus intense d'activité convective, avec une forte convergence en basse couche. Le haut de V représente l'enclume, soufflée par les forts vent d'altitude et évasée par la divergence du flux. Ces orages peuvent se révéler excessivement dangereux du fait de leur stagnation géographique et sont régulièrement associés à des crues-éclair.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Orage monocellulaire, présentant à sa phase de formation une poussée convective très intense que l'on nomme pulsation. Ces orages sont généralement accompagnés de microrafales particulièrement intenses, notamment pendant leur phase d'effondrement.
Voir le dossier Les orages monocellulaires.
Orage monocellulaire à pulsations multiples. Ce système présente durant sa vie une alternance de phases d'intensification et de phases d'effondrement, lui conférant donc une durée de vie nettement supérieure à celle des autres orages monocellulaires.
Voir le dossier Les orages monocellulaires.
Système orageux constitué d'une unique cellule convective non supercellulaire.
Voir le dossier Les orages monocellulaires.
Système orageux constitué de deux ou plusieurs cellules convectives, dont l'organisation générale leur permet d'interagir entre elles.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Système orageux constitué de plusieurs cellules convectives dont la genèse, organisée et hiérarchique, se fait par clonage successif de jeunes cellules à partir de cellules anciennes matures. Il est encore parfois dénommé orage multicellulaire en grappe. Il se présente visuellement comme un alignement de cellules rangées par ordre décroissant, comme des poupées russes ou comme un escalier.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Orage de type monocellulaire, mais possédant des caractères tout à fait particuliers en terme d'organisation structurelle et de développement énergétique qui permet de les extraire des orages monocellulaires classiques et de leur consacrer un nouveau groupe original. Ces orages sont sans conteste les plus puissants, les plus violents et les plus dangereux qui existent sur Terre. Ils se différencient des monocellulaires classiques par l'existence en leur sein d'un mésocyclone profond et persistant.
Voir le dossier Les orages supercellulaires.
Orage supercellulaire qui se distingue des supercellules classiques par l'abondance et la violence de ses précipitations (pluie d'une abondance extrême et grêle de très grand calibre). HP est l'acronyme anglais pour High Precipitation.
Voir le dossier Les orages supercellulaires.
Orage supercellulaire qui se distingue des supercellules classiques par un manque remarquable de précipitations (très peu de pluie et grêle plus mince). LP est l'acronyme anglais pour Low Precipitation.
Voir le dossier Les orages supercellulaires.
Orage de type supercellulaire de taille plus modeste que les trois autres espèces (LP, classique et HP).
Il semblerait que cette structure moins démesurée prédomine sur les trois autres supercellules sur le continent européen.
LT est l'acronyme anglais pour Low Topped.
Voir le dossier
Les orages supercellulaires.
Le pied de pluie, manifestation visible d'une rafale humide, se présente sous la forme d'une excroissance située à la base du rideau de précipitations et évoluant selon un axe horizontal. Il arrive que ce pied de pluie se prolonge ensuite verticalement en direction du courant ascendant lorsque celui-ci est très vigoureux, et finisse par fusionner avec la base du nuage.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Au sein d'un front de rafale, le sillage turbulent se localise entre l'arcus à l'avant, et le rideau de précipitations à l'arrière. Il se manifeste visuellement comme une surface fort tourmentée de la base du cumulonimbus.
Voir le dossier Courants de densité et rafales.
Synonyme de dôme pénétrant, le sommet outrepassant se manifeste visuellement comme un dôme, souvent éphémère, situé au dessus de l'enclume d'un cumulonimbus. Il résulte de l'importante énergie cinétique du courant ascendant de ce cumulonimbus qui amène le courant ascendant à forcer localement la tropopause. Ces sommets outrepassants témoignent donc d'une poussée convective intense, telle qu'on peut l'observer par exemple dans les orages monocellulaires à pulsation ou les orages supercellulaires.
Voir le dossier Instabilité et convection.
Système orageux de grande dimension, issu de la fusion de plusieurs orages multicellulaires. Répondant à des critères de validation bien définis (selon Maddox), leur taille sur le terrain atteint et dépasse souvent 200 km de grand axe.
Voir le dossier Les orages multicellulaires.
Creux de basses pressions barométriques, le thalweg (ou talweg) tire son origine d'une dépression et s'étire entre deux zones de hautes pressions. Le thalweg est à la dépression ce que la dorsale est à l'anticyclone.
Voir le dossier Cyclogénèse et perturbations.
Onde acoustique naissant de la transformation de l'onde de choc générée par la brutale expansion du gaz atmosphérique sous l'effet de la circulation du courant de foudre. Le passage des électrons au sein du canal ionisé du traceur provoque en effet un échauffement extrême (15000 à 30000 °C) des molécules de gaz atmosphérique. Le tonnerre est l'un des sons naturels les plus forts sur Terre. Il suit un éclair après un intervalle de temps proportionnel à l'éloignement géographique de cet éclair par rapport à l'observateur.
Voir le dossier Electricité atmosphérique et foudre.
Synonyme de trombe terrestre, la tornade est un vortex de vents plus ou moins violents qui prend naissance dans des conditions complexes sous les cumulonimbus. Cette colonne atmosphérique tourbillante est rendue visible par la condensation de la vapeur d'eau en son sein, et par les débris qu'elle arrache au sol. Classées actuellement selon l'échelle améliorée (EF) de T. Fujita, les tornades se présentent sous un éventail de puissances allant de la très faible EF0 à l'extrême destructrice EF5.
Voir le dossier Vortex et tornades.Terme habituellement associé à trombe marine, il s'agit d'un vortex de vents évoluant sur une étendue d'eau. Leur intensité est généralement moindre que celle des tornades.
Voir le dossier Vortex et tornades.Frontière délimitant la partie supérieure de la troposphère, et la partie inférieure de la stratosphère. La tropopause est constituée par une zone où la température cesse de décroître, tel le cas dans la troposphère, puis augmente. D'une altitude moyenne de 11 km, elle varie en fait en fonction de la température moyenne de la troposphère sous-jacente, conformément à la loi des gaz parfaits. Ainsi, son altitude est d'environ 8 km aux pôles, et 18 km à l'équateur.
Synonyme de tourbillon, la vorticité consiste en la quantité de rotation que subit un fluide en un point donné de l'espace.
Voir le dossier Vortex et tornades.